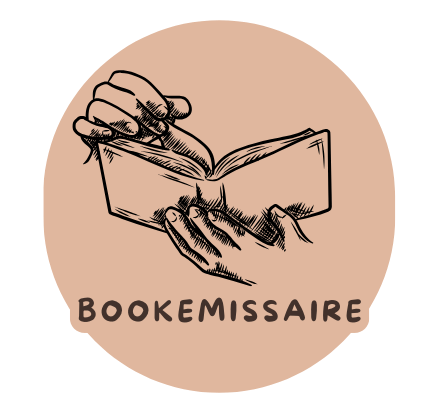© Anthony Quitot
Les Enchanteurs, un James Ellroy grand cru. Autour de la mort de Marilyn Monroe, survenue le 4 août 1962, le maître américain du roman noir tisse sa toile, 650 pages frénétiques pour une intrigue proliférante où il importe peu de distinguer le vrai du faux. Se laisser aller, c’est une valse, mais une valse de mort. Dans le rôle de la mouche, l’Amérique des années 60 — et une éblouissante distribution où mafieux, actrices, policiers et politiciens ne cessent d’échanger leurs rôles et de renverser les alliances au gré des circonstances. Un confrère de James Ellroy a autrefois établi que le facteur sonnait toujours deux fois. De même pour Freddy Otash. Non content de réapparaître sous un jour beaucoup plus sombre que dans Panique générale, cet ancien flic devenu détective privé lance et relance une histoire à double détente. D’abord engagé par Jimmy Hoffa, syndicaliste lié à la mafia, pour espionner Marilyn dans l’espoir de faire tomber John Kennedy, il est ensuite chargé par le clan présidentiel de discréditer à titre posthume la même Marilyn. Beaucoup d’écrivains se contenteraient d’une pareille trame, pas l’auteur du Dahlia noir. Qui l’enrichit d’une affaire d’enlèvement bidon, d’un cold case relatif au meurtre d’un enfant, du désastre de Cléopâtre, film de Joseph Manckiewicz qui manqua envoyer par le fond la Twentieth Century Fox, et de diverses relations amoureuses liant Freddy Otash aux frères Kennedy. Tout un art du récit, ici désigné sous le nom de « convergence ». Les araignées possèdent plusieurs yeux, le romancier au centre de la toile aussi — à moins de reprendre à son sujet ce qu’il dit du personnage principal : « une caméra humaine ». La parenté entre créature et créateur ne s’arrête pas là, même goût pour le voyeurisme, même attrait pour les actrices de seconde zone, même justification des méthodes expéditives contre les criminels et, plus inattendu, même croyance dans la rédemption au sens chrétien du mot. Pour Ellroy, le paradis est pavé de mauvaises intentions. En France pour deux semaines de promotion, il joue à domicile dans notre pays qui l’a élevé comme nul autre parmi plus grands écrivains de notre temps. Lui qui confesse n’avoir jamais lu Balzac en est pourtant le brillant cousin d’Amérique. L’intérêt de converser avec lui tient également à ce que le Dog répond aussi bien aux questions qui ne lui ont pas été posées, d’où quelques envolées sans lesquelles Ellroy ne serait pas tout à fait Ellroy.
Est-ce que vous vous rappelez le jour où Marilyn est morte ?
J’ai entendu la nouvelle à la radio dans la cuisine de l’appartement d’un immeuble pourri où je vivais avec mon père à la limite sud de Hollywood. Et je n’aurais pu m’en foutre davantage. Je n’ai jamais aimé Marilyn Monroe en tant qu’actrice, je n’ai d’ailleurs vu à ce jour que trois de ses films : Quand la ville dort, Niagara et Rivière sans retour. Et je ne l’ai jamais non plus aimé en tant que personne, je la trouve stupide, superficielle — Arthur Miller, son troisième mari, l’a qualifié de monstre, je pense la même chose. Elle pratiquait l’adultère de manière compulsive, elle ne m’inspire aucun respect.
Il peut paraître étonnant que vous n’ayez pas écrit plus tôt sur l’affaire Monroe. Qu’est-ce qui vous a décidé à le faire ?
Le personnage de Freddy Otash en est la raison. J’ai écrit Panique générale dont il était le héros dans un registre comique, dans Les Enchanteurs, il apparaît sous un jour tragique. On l’avait découvert dans les années 50 dans ses activités de fouineur pour journaux à scandale, il fallait le montrer au purgatoire où il confesse ses péchés en attendant qu’il puisse accéder au paradis dans le prochain volume.
Comment avez-vous vécu le fait d’écrire sur quelqu’un que vous n’aimez pas ?
Que les choses soient claires une bonne fois pour toutes : ce n’est pas un livre sur Marilyn Monroe. Elle n’en est qu’un aspect, qu’une partie — si elle peut servir d’argument promotionnel pour attirer le lecteur, tant mieux ! Mais j’ai dit à tous mes éditeurs que je ne voulais pas d’une photo d’elle sur la couverture. Freddy Otash se trouve embarqué dans le cours d’événements qui mèneront au décès par overdose de Marilyn Monroe tandis qu’il enquête sur elle pour le compte de Jimmy Hoffa, lequel veut atteindre John Kennedy par son intermédiaire. C’est ça, l’histoire.
Dans votre processus d’écriture, comment parvenez-vous à combiner l’énorme masse de la documentation disponible et votre imagination ?
En fait, je me fiche de la documentation, mon livre est une pure fiction. J’ai tout inventé : la procédure policière comme la vie de tous les personnages principaux. Je n’ai effectué de recherche que sous une forme négative en lisant la moitié des Vies secrètes de Marilyn Monroe, la biographie d’Anthony Summers où tout est conforme à ce que nous savions déjà, sa mort a bien été causée par une overdose médicamenteuse accidentelle. Il existe ainsi un certain nombre de faits vérifiables à propos des protagonistes du livre ou au sujet de Cléopâtre, ce film ridicule qui faillit causer la faillite de la Twentieth Century Fox, une affaire dont il est beaucoup question dans le roman.
En quoi ce début des années 60 est-il une période importante pour les États-Unis ?
J’y vois un pays sur le point de basculer dans le chaos sous le choc de Camelot, ainsi qu’on désigne la présidence de JFK. J’y vois la montée de la promiscuité sexuelle. J’y vois la psychanalyse devenir un truc immensément barbant. J’y vois les gens perdre leur foi religieuse, ce que je trouve pour ma part abominable. J’y vois l’usage grandissant de la drogue. J’y vois John Kennedy imprégner la culture de son exubérance dérangée. Je l’ai toujours considéré comme un être humain de seconde classe et un président de troisième classe. Alors que j’ai toujours beaucoup respecté Bobby, son puritain de frère.

© Anthony Quitot
Alors comment expliquer la légende dorée autour de Marilyn et de John Kennedy quand la réalité était très différente ?
Parce que les gens sont stupides ! Parce que leur instinct grégaire les pousse à croire certaines choses, comme par exemple que telle ou telle personne a été importante. Ils l’ont tellement entendu dire qu’ils l’acceptent comme une vérité. Pour ce qui me concerne, les gens peuvent bien croire ce qu’ils veulent, je ne suis pas là pour changer le monde, je suis là pour donner un sacré bon roman populaire et obsessionnel — et c’est ce que j’ai fait avec Les Enchanteurs. Mais vous savez quoi ? Je pense que nous vivons des temps médiévaux, que le règne de l’ordinateur, d’internet et de la culture digitale est d’essence satanique. J’exprime là un point de vue chrétien : internet, c’est la domination de Satan sur la planète. Ces jeunes gens qui vivent leur relation amoureuse par ordinateur interposé, alors qu’ils devraient se promener main dans la main et chercher un coin où se peloter.
Pourquoi est-ce Freddy Otash qui raconte l’histoire, un type aussi mauvais, sinon pire, que les gens sur lesquels il enquête ?
Considérez l’arc de sa rédemption. Au début du livre, si vous ne le jugez pas moralement méprisable, cela signifie que vous n’avez pas de colonne vertébrale. Mais si, à la fin du livre, son dernier geste ne vous émeut pas, c’est que vous n’avez pas de cœur. Et dans le prochain livre, il va rencontrer une femme. Une femme qui a vraiment existé. Une chanteuse de folk nommée Judy Henske. Elle s’est produite dans le Judy Garland show au moment où celle-ci n’allait visiblement pas bien, alcool, drogue, etc. Elle chante d’abord une version déchirante de God bless the child, le titre de Billie Holliday. Puis interprète une parodie de chanson folk avec le comique Jerry Van Dyke et le chanteur Mel Tormé. Nous sommes à l’été 63, Kennedy est encore vivant, mais tout est sur le point de merder dans les grandes largeurs. Elle faisait plus d’1m80, beaucoup plus grande que les deux hommes, elle se balance maladroitement sur des talons hauts, fait semblant de loucher. Même ma femme, plutôt sceptique envers mon culte pour des artistes féminines mortes, a été convaincue. Freddy Otash va en tomber amoureux. Vous tenez votre scoop.
Vous avez connu le véritable Freddy Otash ?
Oui. Un sac à merde de classe internationale. Il menaçait de révéler l’homosexualité de certaines personnes dans des journaux à scandale. Difficile de tomber plus bas. Il plaçait des maisons sous écoute dans l’espoir que Rock Hudson se pointerait pour une partie de jambes en l’air. Il allait ensuite voir le patron des studios Universal pour lui dire « Hé, Rock est de nouveau en chasse… » et demander de l’argent contre promesse d’étouffer l’affaire. Il a pratiqué cette forme d’extorsion pendant des années.
Il se montre d’une incroyable violence lors des passages à tabac et il pratique même des exécutions sommaires…
Oui, mais prenez Paul Mitchell Grenier, ce psychopathe qui mord ses victimes jusqu’au sang. Avec un type de ce genre, c’est lui ou vous. Alors vous le descendez avant qu’il ne plante ses dents dans votre gorge. Il doit disparaître, tout comme Albie Aadland, ce tueur d’enfant sans le moindre scrupule. La haute hiérarchie policière sait que Freddy a tué Albie Aadland dans les sous-sols du poste de police, mais Freddy compte sur Robert Kennedy, le Procureur général des États-Unis, pour enterrer le dossier en raison de la liaison qu’il a eue quelques années plus tôt avec Gwen Perloff, la femme dont lui-même est amoureux.
D’évidence, vous n’aimez pas Marilyn Monroe, pas plus qu’elle ne s’aime dans le roman (« Je ne suis qu’une star de cinéma surestimée qui aimerait être quelqu’un d’autre »), mais vous en faites un personnage fascinant, très complexe, un esprit criminel très sophistiqué. C’est d’ailleurs la première fois que Marilyn Monroe m’intéresse vraiment…
Vous ne pouviez me faire plus grand compliment. Dans mon roman, c’est une femme courageuse qui fréquente des gens très, très dangereux dans les derniers mois de sa vie. Sa place dans ma vraie vie tient à ce que j’ai grandi près de Hollygrove, l’orphelinat où Marilyn a vécu une partie de son enfance. Je suis passé devant des milliers de fois et je n’ai jamais vu aucun enfant jouer dans la cour.
Plus le livre avance, plus il devient clair que vous parlez moins d’individus que d’un système global corrompu et criminel.
Le roman porte sur un demi-monde, l’intrication du show-business, des milieux policiers et de la pègre, pas sur les États-Unis en général. En 1962, comme aujourd’hui, la plupart des Américains essaient tout simplement de vivre leur vie, je parle ici d’un univers marginal.
J’aime la manière dont vous parlez d’actrices moins connues que Marilyn, comme Lois Nettleton ou Carole Landis. Comment expliquer que l’une est devenue une star planétaire et les autres pas ?
Question de look, question de timing — et les studios de cinéma ont évidemment joué un rôle décisif dans l’affaire. Sans oublier la vogue de la psychanalyse, dans la mesure où, dès le milieu des années 50, tout le monde savait à quel point Marilyn Monroe était dingue. Une grande part de sa séduction tenait selon moi à une expression parodique de la sexualité féminine. Pour en revenir à la psychanalyse, il est pas mal question dans le roman de sa fixette obsessionnelle pour Paul De River, ce psy corrompu et ses idées bizarres sur la thérapie par un passage à l’acte criminel. Il a même un temps travaillé pour la police de Los Angeles, jusqu’à ce que William Parker le foute à la porte.
Votre histoire d’amour continue avec la France où chacun de vos livres est attendu comme un événement. Comment l’expliquez-vous et cet amour est-il réciproque ?
Vous êtes un pays de lecteurs. La population française représente un cinquième de la population américaine et je vends ici quatre fois plus de livres que dans mon pays et dans ma langue. La France est à l’origine de ma réputation littéraire et le roman dont nous parlons ensemble y est d’ailleurs le mieux accueilli de tous mes livres, sans doute parce qu’il représente la quintessence du roman de détective privé. Les Français ont une profonde compréhension de longue date du roman noir américain — et aussi du film noir américain. Au début du XXème siècle, l’Amérique a été le plus grand exportateur de produits culturels au monde. D’ailleurs, toujours au sujet du roman noir, Albert Camus reconnaissait sa dette envers James Cain — sans Assurance sur la mort ou Mort à la plage, il n’y aurait pas eu L’Étranger. Mais l’ironie tient à ce que la plus importante innovation culturelle venue des Etats-Unis ne fut pas le film, ne fut pas la fiction, mais par-dessus tout le jazz. Et les Français le découvrirent très tôt sans doute parce que vous êtes le pays d’innovateurs comme Olivier Messiaen ou Hector Berlioz. Berlioz, sacrément accro à la drogue soit dit en passant, l’opium en particulier. Et pas seulement. Je crois que c’est à Londres qu’il a vu pour la première l’actrice irlandaise Harriet Smithson dans une pièce de Shakespeare. Et il lui a fallu cette femme à tout prix ! Ça lui a inspiré La Symphonie fantastique, une œuvre folle. Donc, si vous avez déjà pété les plombs avec la drogue, ce qui m’est arrivé, et si vous avez déjà pété les plombs pour une femme, ce qui m’est aussi arrivé, vous aimerez la France et Berlioz. De même que Messiaen qui trouve son inspiration, dans le chant des oiseaux et les églises catholiques. Parole de protestant !
En somme, la France et les États-Unis ne cessent de s’influencer réciproquement…
Oui, le vieux monde et le nouveau monde ne cessent d’échanger des cadeaux culturels. Je voudrais vous dire ceci : nous sommes l’Occident, ce dont nous devrions être immensément fiers ! Nous sommes l’Occident, ce qui ramène à l’esprit le moment où l’alliance occidentale — Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Jean-Paul II, Solidarnosc, Helmut Kohl et François Mitterrand ont abattu l’Union soviétique. Nous avons tué la Bête !
Dans votre livre certains disent que Freddy Otash finira en enfer. Croyez-vous à l’enfer ?
Je crois à l’enfer, je crois à la Sainte Trinité, je crois à la résurrection, je crois en Dieu vivant — je suis un chrétien.
Les Enchanteurs, de James Ellroy, Traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie Aslanides et Séverine Weiss, Rivages, 670 p. 26 €