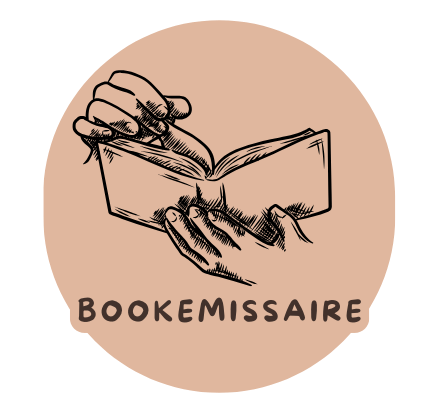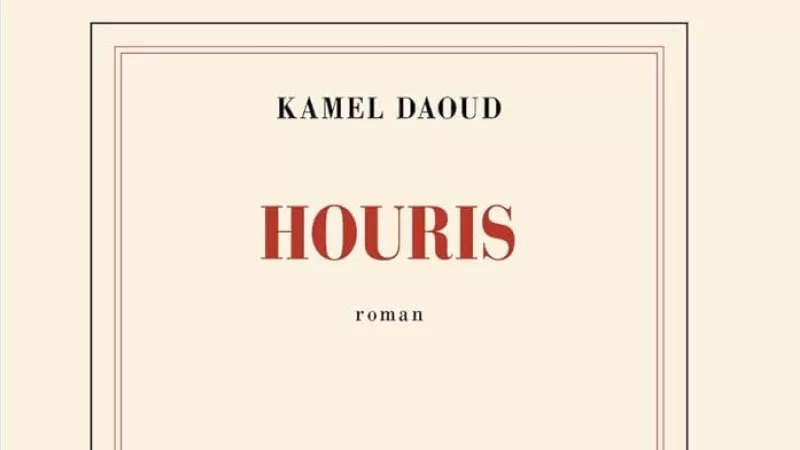Aube est née deux fois. La première lors de sa venue au monde, la seconde quand elle a survécu au couteau d’un islamiste. Elle en a gardé un affreux stigmate, « cette fausse bouche aux lèvres cicatrisées et pincées. » Et un sentiment de culpabilité avivé par le souvenir de sa sœur, morte sous la lame des terroristes. Dans Houris, Kamel Daoud donne voix aux victimes de la décennie noire, 250 000 morts entre 1992 et 2002 selon le bilan officiel. A tous ceux qui ne peuvent s’exprimer, les uns par crainte des conséquences légales, les autres parce qu’ils ont perdu la vie ou l’usage de la parole comme Aube. Avec une attention particulière portée aux femmes dans un pays où « une robe à fleurs trop courte peut décider de ta vie ». Ce roman polyphonique d’une rare force ne revient pas seulement sur une tragédie du siècle dernier. Installé en France, l’écrivain d’origine algérienne nous avertit ici que le passé des uns pourrait devenir l’avenir des autres. A nous d’entendre la mise en garde.
Vous êtes écrivain et journaliste. Qu’est-ce qu’un roman permet de faire, en plus ou en mieux, par rapport à un article de presse ?
J’ai l’habitude de dire qu’on peut mesurer une blessure, mais que pour la raconter, il faut un roman. Le journalisme est une nécessité démocratique, on a besoin du journalisme pour rendre compte du réel et perpétuer ce qui tend à disparaître — à savoir le débat. Mais un article ne permet pas de tout dire, il en demeure un surplus de matière qui reviendra avec l’âge, avec l’expérience, et que seul le roman peut raconter. Cela vaut pour l’auteur comme pour le lecteur. Qu’est-ce qui rend le mieux compte d’une dictature, le rapport d’une ONG ou un roman comme Le Général dans son labyrinthe de Garcia Marquez ? De même que le goulag n’est pas racontable par les chiffres, seulement par la littérature. Le roman permet de mettre sur la table des possibilités de sens (ou de non sens) soumises au lecteur. Comme dit Javier Cercas, le roman n’est pas un genre qui donne des réponses, c’est un genre qui pose des questions.
Bien des lecteurs seront surpris d’apprendre l’omerta qui règne en Algérie à propos de la décennie noire. Au point qu’il est officiellement interdit d’en évoquer les drames et les crimes. Votre livre serait donc en soi un délit ?
Juridiquement, c’est en effet un délit. Sans précédent ou presque, à peine un roman ou deux, quelques films pour la plupart produits en France comme Papicha de Mounia Meddour. Une loi existe, mais volontairement floue, comme il est d’usage dans les régimes autoritaires. Quand on vous dit que l’atteinte à l’islam est punie de 5 ans de prison, qu’est-ce que recouvre au juste le mot « atteinte » ? Ça va de dessiner une caricature au fait de ne pas pratiquer le ramadan. La Charte Nationale pour la paix et la réconciliation de 2005 détermine un verrouillage juridique total par rapport à la décennie noire. On a organisé une amnésie forcée présentée sous le mot de « réconciliation ». On me dit parfois à l’étranger ne pas connaître cette histoire, mais les Algériens de 15 ans ne la connaissent pas non plus ! Ce qui n’est pas enseigné n’existant pas, il n’en reste pas trace. Les islamistes s’en sortent donc avec le beau rôle, puisque, officiellement, ils ne sont coupables de rien, ce qui leur permet de poursuivre leur processus de conquête. C’est une tragédie occultée — au risque qu’elle se répète.
Cette amnésie volontaire est marquée par des touches d’humour noir dans votre roman. Afin de pouvoir les amnistier, on apprend qu’il a été décidé que tous les maquisards islamistes avaient été non pas des combattants, mais des cuisiniers…
Quand l’autoritarisme prend des proportions surréalistes, on y répond par de l’humour — les Juifs le savent bien, tout comme les citoyens de l’ex Union Soviétique. Au rocher de Sisyphe, on n’oppose pas l’effort, plutôt un grand éclat de rire. Ce qui n’empêche qu’ici tout est véridique. Au début des années 90, les islamistes défilaient dans les rues en appelant à ce que les femmes retournent dans leurs cuisines. 10 ans plus tard, il fut donné consigne aux repentis de prétendre qu’ils avaient tous été cuisiniers puisque la loi d’amnistie excluait les poseurs de bombes, auteurs de viols, tous ceux qui avaient du sang sur les mains. Je ne sais s’il faut parler de karma ou d’une moquerie de l’histoire.
Tout le temps de mémoire disponible, si vous me passez cette expression, est consacré à l’autre guerre, la guerre d’indépendance contre la France.
Cela obéit, on le sait, à une logique de rente mémorielle. Mais j’observe que la surenchère mémorielle est survenue après la guerre civile, elle sert à des fins d’escamotage : mieux vaut parler d’une guerre où nous avons été des héros que d’une guerre où nous avons été des bourreaux et des victimes. L’islamisme est d’ailleurs en pointe dans cette surenchère mémorielle — mieux vaut pour eux parler de la colonisation que de ce qu’ils ont commis.
Une des belles idées du roman, c’est le face à face entre le salon de coiffure tenu par Aube et la mosquée, entre le djihad des sens, comme elle le nomme, et le djihad islamiste. Mais comment le reste de la société algérienne se situe-t-elle entre ces deux pôles ?
Dans les dîners entre Algériens, il y a toujours des histoires qui remontent, des choses qui se disent — il n’existe pas un roman unique de la décennie noire, il en existe des milliers. La parole est là, en attente, clandestine, quoi que l’on fasse pour essayer de l’enterrer. Il y a les victimes, qui ne veulent pas en parler, ce qu’on peut comprendre. Il y a ceux qui ne savent pas, les générations suivantes. Et il y a le silence. Les guerres ne signifient pas seulement le bruit et la fureur, elles sont aussi faites de beaucoup de silence. Un silence à part, pas celui des jardins ou des bois — c’est le silence du deuil, le contraire de la prise de parole. Parce qu’on est obnubilé par quelque chose de l’ordre du vide. Je l’ai observé chez beaucoup de gens. Et puis il y a une rupture dans l’ordre logique : la loi d’amnistie et d’amnésie fait que certains événements du présent ne peuvent être expliqués par ce passé dissimulé.
Plus généralement, chacun s’arrange comme il peut entre les deux pôles que vous citez. Il y a de la bigoterie, il y a de la lâcheté, il y a la vie de la nuit et la vie du jour — on peut prier pendant la journée et faire la fête le soir. La vie revient comme la mauvaise herbe, et la bonne aussi, pousse entre les dalles de ciment. Vous pouvez trouver chez la même personne un discours très religieux et un mode de vie sans rapport, un imam dont la fonction est de prêcher et qui mène par ailleurs une vie portée sur les plaisirs sensuels. Le romancier égyptien Alaa al-Aswany a bien décrit cette situation dans son roman J’ai couru vers le Nil, une situation marquée par une grande hypocrisie de part et d’autre. Ainsi que le fait remarquer un de mes personnages — certaines femmes pensent que la meilleure manière d’échapper à une prison est de s’en faire les gardiennes.
Les femmes ont-elles été les victimes par excellence de la décennie noire ?
Les femmes sont sans doute le sujet de mon livre, mais elles sont surtout l’obsession des islamistes. Quel est l’être que l’islamiste déteste le plus ? C’est la femme dans son corps, dans son être, dans sa voix, dans sa sensualité. Les hommes ont tendance à se prendre pour des dieux, mais quand ils se retrouvent en face d’une femme, ils reviennent à leur humanité, c’est peut-être pour ça qu’ils se mettent à la détester.
Vous parliez de la voix des femmes. Votre roman paraît au moment où les talibans interdisent aux femmes de faire entendre leur voix en public. Cette coïncidence signifie-t-elle que l’islamisme à l’algérienne et l’islamisme à l’afghane sont en réalité de même nature ?
Il s’agit d’une illusion intellectuelle occidentale qui consiste à accorder des nationalités différentes à l’islamisme. Les islamistes se réfèrent au même corpus de textes des XIème au XIIIème siècle. Un éditorialiste koweitien s’est étonné avec justesse de ce que certains croyaient que Daech était mort en même temps que son chef al-Baghdadi. Selon lui, les mêmes textes produiraient inévitablement d’autres personnages semblables quelques années plus tard. Les textes en question n’ont pas été réformés pour deux raisons. D’abord, la terreur éditoriale exercée par les islamistes, qui bloque toute réforme ou réflexion. Ensuite, la totale faillite de la gauche arabe, qui ne réfléchit plus sur le texte religieux, soit par peur, certains de ses représentants ont été assassinés, soit par alliance avec les islamistes sur le principe du « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Les islamistes sont hostiles à l’Occident, la gauche arabe est anticoloniale par nature — la seconde prend parfois les premiers pour héros. Les talibans afghans ont au moins le mérite de la cohérence, ils appliquent les textes : la femme ne doit pas faire entendre sa voix, elle doit dissimuler ses formes, etc.
Comment expliquer alors qu’en Occident, certains établissent la distinction dont je vous parlais entre islamisme à l’algérienne et islamisme à l’afghane ?
Par le déni, tout simplement. Mais quand ce déni prend la forme d’une perception intellectuelle ou d’une idéologie, cela devient une catastrophe. Il y a quelques années, un autre journaliste aurait pu poser à un autre écrivain des questions semblables à propos du communisme, du goulag, des disparitions, du stalinisme. Rien de neuf, seuls les noms changent. La thématique reste la même : il s’agit de la vie et de la mort, de la liberté et de son contraire. Chaque époque choisit ses synonymes.
Quelle place la décennie noire occupe-t-elle dans votre propre mémoire et a-t-elle occupé dans votre propre vie ?
Fondamentale. Les plus belles années de ma vie, entre 20 et 30 ans m’ont été volées, je ne peux pas le pardonner. Et cela altère aussi chaque moment de joie. Comme lorsque vous avez perdu quelqu’un, vous avez beau éclater de rire au milieu de vos copains dans un bistro, il y a toujours une autre partie de vous qui vous regarde, qui vous en refuse le droit. Cela ne vaut pas seulement pour l’Algérie, mon livre parlera à un lecteur de Syrie, d’Afghanistan ou d’un quartier difficile de la banlieue parisienne.
« Un pays qui ne veut pas de nous — ou seulement la nuit. » dit une femme dans Houris.
C’est en effet ce que pense mon personnage. Si vous regardez la situation scolaire en Algérie, vous constaterez que les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons. Parce qu’elles savent devoir se battre — faute de quoi, c’est l’enfermement à la maison. Je comprends la colère de mon personnage qui vient au monde dans un pays qui veut la voiler, la nier. Et pas seulement un pays, mais un système, une époque, les siècles accumulés — et cela vaut aussi pour l’Occident. Il faudra un jour avoir le courage de mener une réflexion sur la condition des femmes dans les mêmes termes que celle sur l’esclavage. Pour revenir à ce qu’on appelle le monde arabe, ce qui a été acquis pour les femmes durant les premières années qui ont suivi l’indépendance est en train d’être perdu à cause de la montée des populismes et des conservatismes.
Un des aspects les plus originaux et les plus saisissants de Houris tient dans le parallèle entre l’égorgement pratiqué par les terroristes islamistes et l’égorgement des moutons durant l’Aïd. Quel lien établissez-vous entre les deux ?
Vous savez, certains ont cessé de pratiquer l’égorgement des moutons tout le temps qu’a duré la guerre civile, car le lien leur paraissait évident — celui du sacrifice. Mais il existe une symbolique plus profonde encore : on égorge les générations à venir. Le monde arabe a le culte des ancêtres, pas celui des enfants. Abraham, c’est quelqu’un qui voulait égorger son fils, parce qu’il avait fait un rêve ou qu’il sortait d’une nuit d’insomnie. On peut tirer le mythe dans tous les sens, mais il est dans une certaine logique du monde arabe où plaire à Dieu, c’est égorger son fils. J’observe qu’aucun interlocuteur algérien ne m’a posé votre question, pour eux, cela est significatif. Nous sommes dans une géographie où les mythes ne sont pas apaisés, ils se nourrissent encore de sang.
L’islamisme ne cesse d’avancer ses pions en France, feriez-vous un parallèle avec la stratégie, les méthodes et les résultats de l’islamisme en Algérie ?
On parle de la même matrice, de la même logique. Certains essayent de l’emporter par les couteaux, d’autres par la culpabilisation, d’autres encore par l’entrisme électoral, mais le but reste identique. Nous ne parlons pas de phénomènes nationaux, ceux qui sont partis se battre en Syrie étaient de toutes nationalités. Nous réfléchissons en termes de nations, de drapeaux et de frontières — pas eux. C’est notre faiblesse et ils le savent. Les intellectuels occidentaux s’attaquent, se critiquent, mais vous ne verrez jamais un prédicateur marocain s’en prendre à un prédicateur saoudien.
Comment combattre le plus efficacement la montée de l’islamisme en France ?
Je vous répondrai d’un mot qui vous paraîtra peut-être banal : l’enjeu est culturel. La réponse est l’accès à l’art, l’accès aux livres, ce que j’appelle les tranchées éditoriales. Il n’y a pas d’autre méthode. Si l’islamisme avance dans le monde arabe, c’est qu’il contrôle les médias, l’imprimerie. Et la littérature pour la jeunesse — on fabrique les islamistes au berceau, par les contes pour enfants, par l’école. Tous les fascismes commencent par s’en prendre aux livres, aux écrivains, aux traducteurs. Je ne réponds pas à ceux qui m’interrogent sur la situation politique en Algérie — l’essentiel ne se joue pas lors des élections, mais à l’école. Même chose pour la France, vous ne gagnerez pas cette guerre culturelle sans améliorer le statut des enseignants qui sont à la base de la construction de la République. Il faut les soutenir, il faut y aller ! Imaginez-vous les tranchées de 14-18 avec des profs à la place des Poilus.
Une des questions les plus délicates concerne le débat sur la différence entre islam et islamisme. Quel est votre point de vue sur ce sujet ?
La réponse à cette question procède souvent de la pensée magique des réseaux sociaux : êtes-vous pour ou contre l’islam ? Je juge les gens seulement sur l’aura de bonne ou de mauvaise foi qu’ils dégagent. Je suis sensible à l’humain. Un jour que quelqu’un me disait que l’islam était ou n’était pas ceci ou cela, je lui ai répondu que nous ne vivions pas dans des bibliothèques, mais dans des gares. Nous rencontrons des personnes, pas des livres. Ceux qui expriment leur haine en disant que tout est la faute de l’islam, ne changeront rien à la situation. Pas plus que ceux qui jouent la carte d’un islam victimaire, ils ne feront que dissimuler la réalité. Je suis très camusien en ce sens. Je disais un jour à un religieux que nous n’avons que le Dieu de nos actes.
Votre livre est-il lu Algérie ?
Il est très piraté, oui. Certains lecteurs trouvent le livre déstabilisant, douloureux. Il suscité aussi un certain sentiment de culpabilité au regard du faible nombre d’œuvres inspirées par dix ans de guerre civile. Mais je me tiens un peu à distance de ces réactions, parce que vous êtes à nu quand vous sortez un roman, le moindre mot vous écorche. Et puis je me protège en même temps de la vanité d’auteur.
Quel regard portez-vous sur l’élection présidentielle qui vient d’avoir lieu en Algérie ?
Comme je vous l’ai dit, cela n’est que la lointaine conséquence de ce qui se passe à l’école, le sujet essentiel pour moi. Il n’y a pas d’autre enjeu que de construire un barrage éditorial, culturel. La catastrophe, ce n’est pas une élection. La catastrophe, c’est lorsque les livres de contes et de rêverie tombent sous la coupe d’un milieu idéologique précis.
Le personnage d’Aïssa dit à un moment : « Je continue à deviser. J’ai été envoyé, ce n’est pas ma faute. Je suis un messager. » N’est-ce pas aussi votre rôle, celui d’un messager ?
Je me considère plus humblement comme un témoin. J’ose prendre la parole, au risque de l’interprétation et de la surinterprétation. Je me trouve entre deux pays, deux cultures, deux langues, deux livres. C’est un sort et une richesse. Je n’ai ni à l’expliquer, ni à le justifier. La précarité est nécessaire à la réflexion, d’être entre deux rives, c’est comme se tenir à une fenêtre qui donne sur deux rues différentes. Il faut laisser à la vérité aux morts, nous sommes là pour fabriquer du doute et des questions.
Houris de Kamel Daoud a remporté le prix Goncourt 2024.